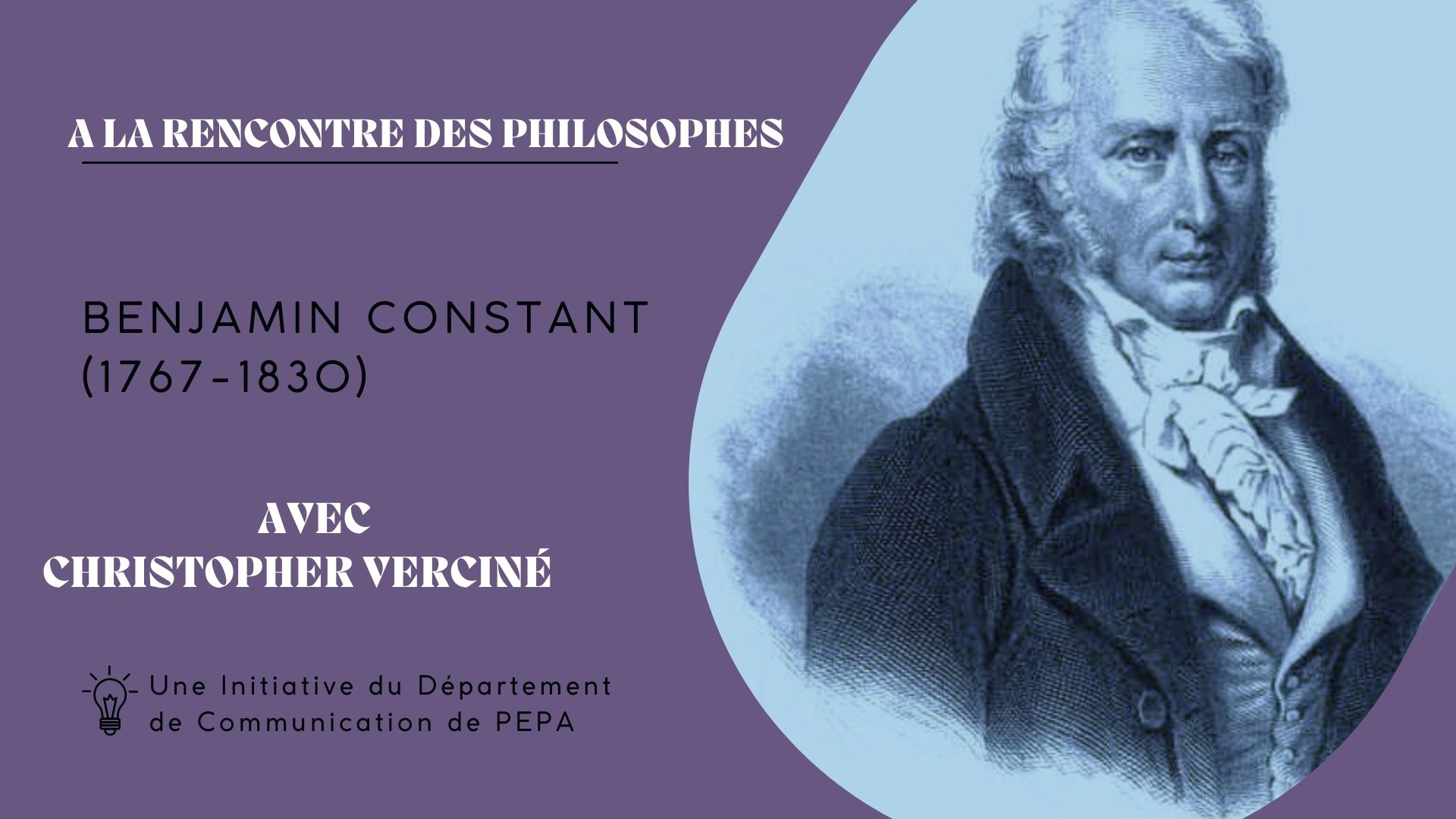Benjamin Constant : Parcours d’un intellectuel entre révolution et libéralisme
Né le 25 octobre 1767 à Lausanne, Benjamin Constant descend de protestants français réfugiés en Suisse. Il appartient à une famille de hobereaux qui louaient leurs services aux armées étrangères. Il reçoit une éducation disparate, qu’il a décrite avec humour dans le Cahier rouge. Livré à des précepteurs médiocres, il fait néanmoins preuve de talents précoces, notamment dans les langues anciennes et la musique. À douze ans, il écrit un roman héroïque, Les Chevaliers. Ballotté à travers l’Europe par son père (Bruxelles, 1774 ; Londres, Oxford, 1780 ; Erlangen, 1782 ; Édimbourg, 1785 ; Paris, 1785 et 1787), son instruction très vaste souffre pourtant d’un manque de continuité. De 1788 à 1794, Constant exerce durant six ans la fonction de chambellan à la cour de Brunswick, un séjour morose, rendu encore plus sombre par un triste mariage, bientôt rompu. Il trompe son ennui en se dévouant pour sauver l’honneur et la fortune de son père, compromis dans un interminable procès militaire. Le jeune Vaudois en conçoit une haine à l’égard de l’aristocratie bernoise, affiche son goût pour la démocratie, se lie avec Jacob Mauvillon et s’intéresse de plus en plus à la Révolution. Cette évolution l’émancipe peu à peu du mentorat d’Isabelle de Charrière, avec laquelle il était lié depuis 1787. Ses déboires ne l’empêchent pas de travailler ; il découvre la théologie allemande et nourrit sa réflexion de l’exemple de Frédéric II et du joséphisme. C’est donc un jeune homme brillant, mais un peu amer et désabusé, que rencontre Mme de Staël le 18 septembre 1794 à Lausanne.
Les commentateurs ont longtemps tenu le libéralisme de Constant pour une simple rationalisation de l’égoïsme et de l’intérêt matériel ou comme un écran idéologique au triomphe d’un gouvernement élitiste. Ces reproches, comme ceux qui l’associent à une girouette, datent de l’époque même de Constant, et l’historien polémiste Henri Guillemin s’en est fait l’un des plus bruyants porte-parole.
Depuis une trentaine d’années cependant, les travaux sur les écrits, les manuscrits et la pensée de Constant ont complètement invalidé cette vision. L’édition des Principes de politique (1806-1810), éditée en 1815 (Paris, Eymery) et rééditée en 1957 pour la première fois depuis l’édition originale de 1815, dans les *Œuvres de Benjamin Constant*, a constitué un moment important à cet égard. On s’est de même rendu compte de l’unité de l’œuvre de Constant, loin des images de girouette : tant que les principes qu’il promeut peuvent être appliqués, peu lui importe en somme le mode de gouvernement (république, Empire ou monarchie constitutionnelle), d’où cette image qui lui a longtemps collé à la peau de serviteur déloyal aux régimes qui l’emploient.
Constant est connu pour son abondante correspondance, son journal intime (1804-1816), et ses récits plus ou moins autobiographiques, dont Adolphe, publié en 1816 à Paris. Selon le critique Charles Du Bos (1882-1939) : « l’égal de quiconque mais, pas plus que son esprit, sa langue ne témoigne d’aucun indice national. Elle est classique mais sans le tour classique. »
Benjamin Constant note dans son journal à la date du 11 février 1804 : « L’art pour l’art, et sans but ; tout but dénature l’art. Mais l’art atteint au but qu’il n’a pas. » La formule annonce ce que professera la génération suivante des pré-parnassiens comme Théophile Gautier et Théodore de Banville, ainsi que les poètes du Parnasse tels que Leconte de Lisle. Cette doctrine de l’amour de la forme, du rejet de l’utile attirera aussi un moment Baudelaire, sans toutefois le retenir.
Avant d’être un philosophe, Constant fut un lecteur passionné et un écrivain. Il avait une excellente connaissance de la philosophie et du romantisme allemand (Kant, Schelling, Schlegel). Il entre en 1796 dans unque avec le philosophe de Koenigsberg qui soutenait que dire la vérité était un devoir moral indépendant du contexte. Il est l’auteur d’essais dans lesquels il pose des questions politiques ou religieuses, comme De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s’y rallier publié en 1796 et De la religion considérée dans sa source, ses formes et son développement, mais également de romans psychologiques où il évoque le sentiment amoureux comme Le Cahier rouge, écrit en 1807 mais publié à titre posthume, où l’on retrouve des éléments autobiographiques de son amour pour Mme de Staël. Il décède de maladie le 8 décembre 1830 et est inhumé au cimetière parisien du Père-Lachaise.
Christopher VERCINÉ